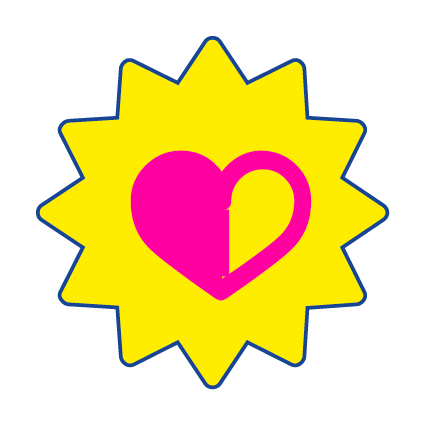Ma classe écrit
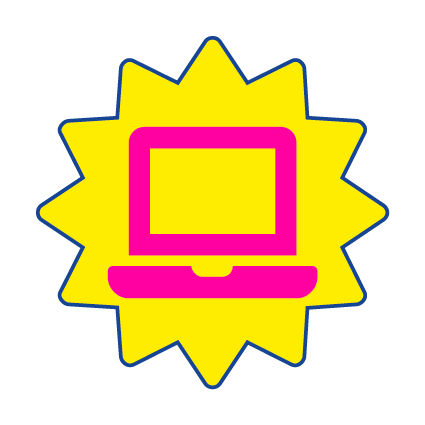
Les cinq nouvelles ainsi rédigées, sur tablettes ou ordinateurs, sont ensuite éditées selon des normes professionnelles sous la forme de livres numériques.
Une sixième séance de promotion littéraire est organisée dans les établissements scolaires participants : accompagnés par la vidéaste Manon Gary, les élèves sont invités à « pitcher » leur nouvelle, face à la caméra. À l’oral, ils s’exercent à la résumer et à restituer leur expérience d’atelier de manière convaincante.
3°2 du collège François Mitterrand, Simiane-Collongue
5°3 du collège La Chesneraie, Puyricard
4°D du collège Elsa Triolet, Marseille, 15e
4°G du collège Jean-Claude Izzo, Marseille, 2e
4°D du collège Gérard Philipe, Martigues
Auteurs accompagnateurs
Louise Mottier
Sigolène Vinson
Sébastien Joanniez
Marc Alexandre Oho Bambe
Julien Delmaire
Les auteurs accompagnateurs en 2024-2025

Julien Delmaire est poète et romancier. Depuis plus de vingt ans, dans la tradition du spoken word, il déclame ses textes sur scène, en France et dans le monde.
Il anime de nombreux ateliers d’écriture dans les écoles, les hôpitaux psychiatriques et en milieu carcéral. Auteur de romans et de recueils de poèmes, il écrit aussi pour la jeunesse et le théâtre.
Bibliographie sélective
- Fragments bombardés du bonheur, Éditions 110 Véronique Rieffel, 2024.
- Blues in the Blood (traduction), Seagull Books, 2023.
- Delta Blues, Grasset, 2021.
- Minuit, Montmartre, Grasset, 2017.
- Les Aventures Inter-sidérantes de l’Ourson Biloute, avec Reno Delmaire (illustrations), Grasset Jeunesse, 2017.

Publiée dans différentes maisons d’édition, l’œuvre de Sébastien Joanniez alterne entre littérature jeunesse et adultes, roman, théâtre, poésie, album, cinéma, opéra, chanson, marionnette, récit, chronique de voyage. Auteur et comédien, il lit régulièrement ses textes à haute voix et joue sur scène des spectacles destinés à tous les publics. Il participe également à de nombreux projets (ateliers d’écriture, rencontres, scènes ouvertes…) dans les milieux scolaires, culturels, hospitaliers, pénitentiaires, associatifs, institutionnels.
Bibliographie sélective
- Des jours comme des nuits, Rouergue, 2024.
- Il y a mieu, La maison théâtre, 2024.
- On a supermarché sur la lune, La Joie de lire, 2022 (mention spéciale du prix Vendredi 2022).
- Entrez !, avec Joanna Concejo (illustrations), Format, 2023.
- Moins bête, avec Régis Lejonc (dessins), L’École des loisirs, 2019.
- Chouf, Espace 34, 2014.

Louise Mottier s’est formée en sciences sociales et en affaires européennes avant de s’engager dans l’aide aux personnes migrantes, notamment auprès d’enfants et de femmes exilés, à Paris, Marseille et Gênes. Sur ce sujet et à partir de son expérience, elle a publié un essai, Les Conquérants. Avec les mineurs non accompagnés. En 2025, elle publie son premier roman, Bâtiment Babinski.
Bibliographie
- Les Conquérants. Avec les mineurs non accompagnés, Hors d’atteinte, 2021.
- Bâtiment Babinski, Hors d’atteinte, 2025.

Poète slameur et romancier, Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, sème des notes et des mots, de résistance et de paix, de mémoire et d’espoir.
Il inscrit ses poèmes et ses pas dans ceux, essentiels, de ses guides à penser et de ses professeurs d’espérance : sa poésie chante les possibles, le don de soi, l’amour et la révolte, la quête de l’humain. Il est membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune. Marc Alexandre Oho Bambe a été fait Chevalier de l’Ordre national du mérite en 2017 et maître ès jeux de l’Académie des Jeux floraux en 2022.
Bibliographie sélective
-
- Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, Calmann-Lévy, 2023.
- Nobles de cœur, Calmann-Lévy, 2022.
- La vie poème, Mémoire d’Encrier, 2022.
- Les lumières d’Oujda, Calmann-Lévy, 2020. Prix littéraire des Rotary Clubs de langue française 2020.
- Diên Biên Phù, Sabine Wespieser Éditeur, 2018. Prix Louis Guilloux 2018.

Sigolène Vinson est écrivaine et chroniqueuse judiciaire pour Charlie Hebdo. Avant cela, elle s’est formée au Cours Florent et au Cours Viriot, a joué dans des clips vidéo, des courts-métrages ou encore au cinéma. Elle s’est finalement orientée vers le droit pour exercer la profession d’avocate. En 2007, elle a abandonné ce métier pour devenir écrivaine. Son œuvre, sensible et inclassable, mêle réflexions sur l’enfance, l’écologie et la condition humaine. Elle est l’autrice de quatre romans.
Bibliographie sélective
- La Palourde, Le Tripode, 2023.
- La Canine de George, Éditions de l’Observatoire, 2021.
- Maritima, Éditions de l’Observatoire, 2019.
- Le Caillou, Le Tripode, 2015.